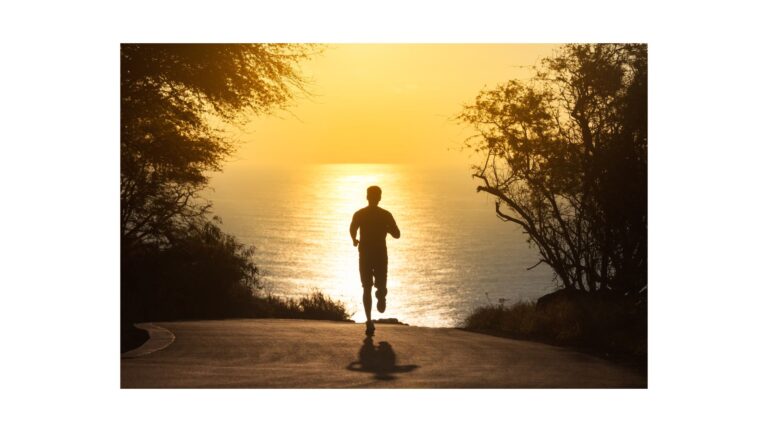Et si le corps suivait une partition écrite ailleurs ?
On croit souvent que l’allure en ultra-trail est une affaire de jambes. De VO2 max. De calculs savants faits sur une montre GPS ou dans une cellule mentale d’analyse de pente, d’altitude, de fatigue. Mais que se passe-t-il si, au fond, ton allure ne venait pas de ton corps… mais de ton esprit ? De ton rapport au monde ? De ta capacité à tolérer l’inconfort, à négocier avec l’invisible ? Et si courir était d’abord une affaire d’interprétation, de signaux internes, de mémoire émotionnelle et de récits silencieux ?
Peut-on réellement courir librement si l’on n’a pas d’abord appris à lire ce que notre allure dit de nous ?
Certaines études scientifiques, en particulier les travaux de Baron, Grappe et Groslambert (2018), proposent une grille de lecture radicalement nouvelle : le pacing, cette régulation de l’effort dans la durée, ne dépend pas seulement du glycogène ou des fibres musculaires. Il résulte d’un entrelacement d’émotions, de sensations, de désirs, de récits intérieurs et de motivations profondes. Il est un art du compromis entre le plaisir et la douleur, entre ce que l’on veut et ce que l’on peut. Et surtout : entre ce que l’on accepte et ce que l’on refuse.
En ce sens, chaque foulée devient un acte philosophique. Un choix métabolique, certes, mais surtout un choix existentiel.
Courir, ce n’est pas avancer. C’est décider pourquoi continuer.
Car l’allure n’est pas un objectif. Elle est un miroir : celui de notre climat intérieur. Elle fluctue au rythme de nos doutes, de nos élans, de notre courage parfois, ou de notre peur plus souvent. Dans l’espace incertain de l’ultra-endurance, la vitesse ne dit pas seulement le niveau d’entraînement, elle raconte aussi le niveau d’engagement intérieur.
Alors, plutôt que de demander : « À combien dois-je courir ? », peut-être faut-il oser une autre question : « Qu’est-ce qui, en moi, ralentit ? »
Le faux contrôle : effort perçu ≠ effort réel
Il y a, dans la solitude des sentiers de trail, une illusion qui persiste : celle que notre corps dicte nos limites. Comme si l’altimètre, le chrono ou le cardiofréquencemètre avaient le pouvoir de décrire ce que nous vivons réellement. Cette croyance, pourtant rassurante, est démentie par la neurobiologie contemporaine, la psychologie de l’endurance et les récits intimes de celles et ceux qui courent plus pour comprendre que pour gagner.
Ce que nous appelons « effort » n’est pas la somme des contractions musculaires ni le taux de lactate mesuré dans le sang. L’effort, en vérité, est une expérience. Une perception. Et comme toute perception, elle est sujette à interprétation, traversée de biais, de récits préfabriqués et d’histoires que nous nous racontons à propos de nous-mêmes.
Baron et al. (2018) l’ont résumé avec une justesse presque stoïcienne : « L’effort n’est pas ce qu’on fait, c’est ce qu’on accepte. »
Ce qu’on accepte. Le verbe est capital. Car la course n’est jamais une simple dépense énergétique. Elle est un compromis. Une négociation intime entre ce que je veux préserver, mon confort, mon intégrité, mon image, et ce que je veux atteindre, une ligne d’arrivée, un dépassement, une vérité peut-être. On ne ralentit pas uniquement parce que le corps ne peut plus ; on ralentit aussi parce que l’esprit ne veut plus consentir.
La recherche en psychologie (de la motivation notamment) l’appelle « ratio motivation/effort perçu ». Ce n’est pas le niveau absolu d’effort qui limite la poursuite, mais la capacité mentale à tolérer cet effort dans la durée. Autrement dit, la performance ne dépend pas uniquement des jambes, mais du sens que l’on donne à l’inconfort qu’elles supportent.
Prenons deux coureurs dans un ultra-trail. Tous deux sont au 70e kilomètre. Leurs constantes physiologiques sont similaires. Mais l’un est porté par un projet symbolique fort, courir pour son père défunt, pour une promesse faite, pour une cause qui le dépasse. L’autre, au contraire, doute du pourquoi. Il court parce qu’il s’était inscrit, parce qu’il n’ose pas abandonner, mais il n’est plus sûr du sens de sa démarche. Le premier accélère malgré la douleur. Le second marche, s’arrête, lutte contre lui-même.
Les données physiologiques ne suffisent donc plus à prédire l’allure. Il faut convoquer d’autres disciplines : les neurosciences affectives, la phénoménologie de la douleur, la théorie de l’esprit incarné (Damasio, 2000), et même l’anthropologie des rituels d’engagement (Graeber, Morales). Car l’allure n’est pas qu’une mesure de vitesse. C’est un récit qui s’écrit au présent avec les moyens du bord : motivation, mémoire, émotions, croyances.
Cette confusion entre effort perçu et effort réel est précisément ce que le Central Governor Model (Noakes, 2007) ou le psychobiological model (Marcora, 2008) tentent de modéliser : la performance serait autorégulée, non par les limites du corps, mais par les limites acceptables du désagrément anticipé. Courir devient alors une forme d’allégorie : ce que je crois être un mur est souvent une simple résistance à l’idée de continuer.
Dans le langage courant, on dit : « Je n’ai plus rien dans les jambes ». Mais souvent, ce n’est pas le glycogène qui manque. C’est la narration intérieure qui s’est effondrée. Le sens vacille. L’axe symbolique s’effrite. L’envie n’a plus de racines. Le corps ne lâche pas ; c’est l’adhésion au projet de courir qui s’évapore.
Face à cette complexité, il est utile de se poser une question simple, presque triviale, mais décisive : est-ce que ce que je ressens vaut encore ce que je poursuis ?
Et si la réponse est non, le ralentissement devient inévitable, peu importe l’état réel du corps.
À l’inverse, certains coureurs trouvent dans la douleur une densité de présence qu’aucun entraînement ne peut simuler. Ils courent non pas malgré l’effort, mais à travers lui. L’effort devient alors un miroir. Non plus de leurs limites, mais de leur capacité à rester engagés, à faire le choix, minute après minute, de continuer, non pas pour finir, mais pour être dans la course.
Ainsi, le pacing n’est pas une stratégie mécanique mais une chorégraphie entre volonté, valeurs, sensations et acceptation. Il ne se commande pas ; il se découvre. Il ne s’impose pas ; il s’ajuste.
Et si l’allure n’était qu’un révélateur, non de ta force physique, mais de ton degré d’alignement intérieur ?

Quand les émotions tracent l’allure
Il est un mythe tenace dans le monde de l’endurance : celui du coureur stoïque, imperméable à ses émotions, avançant tel un métronome insensible à la souffrance, aux doutes, aux fulgurances de joie. Un idéal viril et robotique hérité d’un modèle héroïque du dépassement de soi. Pourtant, rien n’est plus faux. Et rien n’est plus contre-productif.
Car le traileur, s’il veut durer, ne peut être un simple moteur. Il doit devenir un baromètre. Non pas pour prédire la pluie ou l’effondrement, mais pour lire à l’intérieur de lui-même les variations fines de son état émotionnel, afin d’y répondre non par la force, mais par l’ajustement.
Le modèle de Global Pacing Process de Baron et al. (2018) introduit donc ici un concept aussi poétique que scientifique : l’équilibre affectif. Ce n’est pas seulement l’effort qui compte, mais ce qu’il coûte subjectivement par rapport au plaisir ou au sens qu’il procure. Une sorte de balance interne, constamment recalculée : d’un côté l’intensité du désagrément, de l’autre, la valeur de l’engagement. Si ce que je ressens devient plus lourd que ce que je poursuis, je ralentis. Si l’émotion, même fugace, réinjecte du désir, je relance.
Ainsi, courir devient une activité émotionnelle à part entière. Il ne s’agit pas de “gérer ses émotions” comme on gère un budget. Il s’agit plutôt de les écouter comme des instruments sensibles, comme des alarmes fines, parfois exagérées, parfois salvatrices. L’émotion n’est pas un parasite ; c’est un message. La peur peut signaler un risque réel. Le dégoût peut masquer un besoin de repos. L’euphorie, elle, peut précéder un excès.
Prenons un exemple concret : à la sortie d’un ravitaillement, après 60 kilomètres, un coureur se sent “vide”. Pas de douleur précise. Pas de signe d’hypoglycémie. Mais une sensation de flou, de désengagement. Il n’arrive plus à se projeter dans les vingt prochains kilomètres. Il baisse les yeux, ressent une forme d’indifférence. Ce n’est pas son corps qui lâche, mais son lien avec ce qu’il est en train de vivre. Une déconnexion, souvent ignorée, qui précède l’abandon bien plus sûrement qu’une crampe.
L’intelligence émotionnelle, telle que définie par les neurosciences sociales (Panksepp, Damasio, Goleman), consiste précisément à identifier ce moment, le nommer, puis agir dessus. Cela peut être une pause, une musique, une pensée ressource, une image mentale, un souvenir fondateur. Ce n’est pas fuir l’émotion. C’est lui répondre par un choix.
Dans une étude menée sur les stratégies de régulation affective pendant les épreuves d’endurance (Lane et al., 2011), on observe que les coureurs qui acceptent leurs fluctuations émotionnelles, sans les dramatiser ni les nier, maintiennent mieux leur niveau de performance. L’émotion, intégrée, devient un levier. L’émotion, ignorée, devient un poids.
Ce principe se retrouve aussi dans les pratiques de pleine conscience appliquées au sport (Kabat-Zinn, Hutchinson, Odgen), où l’on apprend à observer l’apparition de la douleur ou de la peur comme une vague, sans s’y accrocher, ni la rejeter. Accepter de ressentir, sans sur-réagir, devient un facteur de robustesse.
Car au fond, l’endurance n’est pas l’aptitude à résister. C’est l’art d’habiter le temps qui passe, y compris quand il fait mal. L’émotion ne doit pas être expulsée. Elle doit être transmuée.
Dans les grandes courses de montagne, certains coureurs parlent de “traversée intérieure”. Ce ne sont pas des mots choisis au hasard. Le trail, dans sa durée, nous oblige à passer à travers, à travers des paysages, certes, mais surtout à travers nos états mentaux. La colère, la joie, la solitude, la gratitude, l’ennui même : autant d’expériences qui s’enchaînent dans un ballet parfois chaotique, mais profondément humain.
C’est pourquoi il ne suffit plus de mesurer son allure, son seuil, sa fréquence cardiaque. Il faut aussi apprendre à mesurer ce qui se joue dans l’invisible : le poids d’un doute, la lumière d’un souvenir, la puissance silencieuse d’une intention juste.
Et si, à chaque instant, notre capacité à avancer n’était rien d’autre que la réponse silencieuse à une question simple : “Est-ce que ce que je ressens vaut encore ce que je poursuis ?”
Quand les émotions tracent l’allure
Lorsque tout vacille, muscles, genoux, repères, certitudes, il ne reste parfois qu’une chose : le pourquoi. Cette énigmatique persistance du sens, même lorsque l’endurance semble s’effondrer, agit comme un fil tendu dans la tempête.
De nombreux coureurs d’ultra vivent ce moment singulier. Le corps proteste, la lucidité chancelle, l’abandon devient une option raisonnable. Et pourtant, quelque chose en eux résiste. Ce n’est ni de l’orgueil, ni une pulsion de victoire. C’est plus profond. Une sorte de cohérence intime entre la souffrance vécue et une valeur que l’on ne peut trahir.
La psychologie nomme cela la motivation intégrée. Elle survient lorsque l’action entreprise est non seulement choisie, mais pleinement alignée avec l’identité de celui qui agit. À ce stade, courir ne répond plus à un objectif externe, mais à une nécessité intérieure. Ce n’est plus seulement une question de performance, mais d’intégrité.
Edward Deci et Richard Ryan, dans leurs travaux sur la théorie de l’autodétermination, décrivent ce niveau de motivation comme celui où l’individu agit en accord profond avec ses convictions. Il ne s’agit plus d’aller au bout d’une course, mais de ne pas rompre un pacte silencieux avec soi-même.
Beaucoup de finishers d’ultra-trail le décrivent ainsi :
« Je ne pouvais pas abandonner. J’aurais eu l’impression de me trahir. »
Le sens ne supprime pas la douleur, mais il la rend habitable. Ce n’est pas une négation de la souffrance, c’est un changement de perspective : la douleur cesse d’être un obstacle, elle devient une composante du chemin. Le mouvement n’est plus une performance, il devient fidélité à une image de soi, à une histoire, à une promesse.
Cette bascule mentale a été observée dans d’autres situations extrêmes. Viktor Frankl, psychiatre et rescapé des camps de concentration, affirmait que ceux qui avaient un pourquoi pouvaient survivre à presque tous les comment. En ultra-endurance, cette idée prend un relief singulier : au cœur de la fatigue, le sens devient une forme d’énergie. Non mesurable, mais décisive.
Certaines études en neurosciences (1) ont montré que les décisions de persévérer sous contrainte activent des zones du cerveau associées non pas à la force brute, mais à la mémoire autobiographique, aux valeurs et à la représentation de soi. Le striatum ventral, impliqué dans la motivation et la valorisation des actions, joue un rôle déterminant dans la capacité à continuer. On avance non parce qu’on en a encore la force, mais parce qu’on se souvient de qui l’on est, ou de qui l’on veut être.
Dans son livre Endure, Alex Hutchinson évoque ces seuils invisibles, que l’on ne franchit pas avec les jambes, mais avec l’imaginaire. Le souvenir d’un enfant, d’une promesse faite, d’un moment attendu à l’arrivée, peuvent suffire à prolonger l’effort. Il ne s’agit plus alors d’endurance physique, mais d’un exercice d’adhésion existentielle.
Dans ces instants, la course cesse d’être un simple défi. Elle devient une conversation avec ce qui, en nous, tient encore debout. On ne se demande plus combien de kilomètres il reste, mais pourquoi l’on continue. Et si la réponse est suffisamment claire, les jambes suivront.

Le pacing, fruit d’une régulation incarnée
L’allure ne se programme pas, elle se négocie. Minute après minute. Dans ce commerce discret entre désir et renoncement, entre lucidité et espoir. Ce n’est ni la montre, ni le plan d’entraînement, ni la prévision énergétique qui dicte le rythme. C’est un ajustement sensoriel et symbolique, où le corps dialogue avec l’esprit, parfois dans la coopération, souvent dans la tension.
La performance en trail, contrairement à d’autres sports, ne tolère pas le mensonge longtemps. Si tu commandes à ton corps une allure qui ne reflète pas ton état intérieur, il finira par te le rappeler. D’abord par l’essoufflement, ensuite par la douleur, puis par l’idée d’abandon. Et ce rappel n’est pas une défaite. Il est un retour au réel.
Repenser le pacing, c’est donc accepter qu’il n’est pas l’expression d’un volontarisme héroïque, mais la manifestation d’une forme d’intelligence adaptative. Celle qui ajuste à chaque instant ce que l’on croyait possible, en fonction de ce que l’on ressent profondément.
Ce que la neurophysiologie nous apprend, c’est que cette régulation n’est pas qu’un phénomène musculaire ou métabolique. C’est une orchestration fine entre cortex préfrontal, striatum ventral et systèmes de feedback sensoriel. Une partition jouée par un organisme vivant, chargé d’émotions, de doutes, de souvenirs et d’intentions.
La question du pacing devient alors : suis-je encore en accord avec ce que je poursuis ? Si oui, je peux continuer. Sinon, j’avance mécaniquement, mais déjà désengagé.
Autrement dit, ce n’est pas ton allure qui guide ton état intérieur. C’est ton état intérieur qui façonne ton allure. Courir ne devient plus un simple acte de locomotion, mais une forme d’expression de soi. Ce que ton allure dit de toi, à ce moment précis de la course, a souvent plus de vérité que tous les discours sur la performance.
Ce que tu peux donner change à chaque instant. Et ce que tu veux atteindre aussi. Le pacing est l’art de naviguer entre ces deux rives, sans jamais les figer. C’est peut-être pour cela qu’il est si difficile à enseigner, mais si précieux à ressentir.
Les signes du corps, les messages de l’esprit
Sur un ultra, tout se brouille : les repères deviennent flous, les perceptions se distordent, les émotions s’amplifient. L’allure devient une affaire de décodage.
Ce n’est plus seulement ton cardio qu’il faut écouter, mais ce que ton état intérieur essaie de dire, à travers les micro-signaux, les tensions invisibles, les pensées intrusives ou les silences inhabituels.
Le traileur expérimenté ne cherche pas seulement à avancer. Il apprend à interpréter.
Il s’entraîne à distinguer :
une fatigue physique d’un surmenage mental,
un effondrement physiologique d’une baisse de sens,
une lassitude transitoire d’un désalignement profond.
Les signes sont là, encore faut-il les reconnaître à temps. Pour cela, voici quelques situations mentales fréquentes et des clés de lecture simples, issues à la fois des travaux en psychologie de la performance, en régulation émotionnelle et en pratique de terrain.
Table des signaux mentaux et leviers d’ajustement
| Situation mentale | Ce que cela révèle | Piste d’ajustement concret |
|---|---|---|
| Tu te sens agacé, dispersé, peu concentré | Désalignement entre action et intention | Revenir à l’instant : respirer, se fixer un micro-objectif |
| Ton allure chute sans explication physique | Perte de sens, saturation émotionnelle | Pause symbolique, reformulation du “pourquoi” |
| Tu envisages d’abandonner alors que ça va | Fatigue mentale > fatigue physique | Se dire : “Juste jusqu’au prochain ravito” |
| Tu accélères sans raison au 70e km | Surcompensation émotionnelle (euphorie, fuite) | Se recentrer, réguler par la respiration, redoser son allure |
| Tu veux pleurer ou tout envoyer valser | Trop plein d’affects, surcharge sensorielle | Prendre quelques minutes seul, loin des autres coureurs |
| Tu n’éprouves plus rien, même plus la douleur | Dissociation émotionnelle, mécanisme de protection | Boire, s’alimenter, stimuler le contact (musique, voix) |
La lucidité ne réside pas dans la toute-puissance. Elle commence là où l’on sait écouter.
Il n’y a pas de stratégie miracle, pas de schéma unique. Mais une forme d’intelligence du sensible qui, quand elle est cultivée, permet d’éviter les pièges de l’ego, d’anticiper les coups de mou, et parfois, de trouver dans le chaos un chemin plus vrai que celui qu’on avait prévu.
Conclusion: L’allure ne ment jamais ?
Courir longtemps, ce n’est pas simplement tenir une vitesse. C’est apprendre à écouter ce que cette vitesse nous dit. Le pacing n’est pas une commande extérieure, dictée par une montre GPS ou un plan d’entraînement, mais une conséquence dynamique, souvent inconsciente, de notre rapport à l’effort, au plaisir, au sens et à soi.
Quand on ralentit, ce n’est pas uniquement parce qu’on est fatigué. C’est parfois parce qu’on doute. Parce que la valeur de continuer ne dépasse plus le coût de l’inconfort. L’allure devient alors un reflet brut : non pas de notre forme physique, mais de notre alignement intérieur.
Le traileur d’aujourd’hui court entre deux mondes : celui de la donnée objectivée (fréquence cardiaque, puissance, pacing, altimétrie) et celui de la sensation vécue (plaisir, refus, mémoire, silence intérieur). Le plus grand défi n’est peut-être pas de choisir entre les deux, mais d’apprendre à les faire dialoguer, à faire de la donnée un miroir, et non un maître.
Demain, les dispositifs de mesure pourraient devenir plus qu’un simple affichage de métriques : ils pourraient s’intégrer dans un modèle adaptatif de l’état psychophysiologique du coureur. En croisant :
- le rythme cardiaque
- la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV)
- les données de foulée (cadence, oscillation verticale, symétrie)
- les expressions faciales ou vocales (captées par micro ou caméra discrète)
- les auto-évaluations subjectives d’effort et de plaisir (en direct via bouton ou retour vocal)
… il deviendrait possible de créer une carte dynamique de l’état intérieur du coureur. Une “interface de soi” augmentée.
Mais la vraie avancée ne sera pas dans la précision de l’algorithme. Elle viendra de notre capacité à concevoir ces outils comme supports d’introspection, non comme autorité de commande. Des technologies embodied, enracinées dans l’écoute, et non dans la dictature du chiffre.
Un jour, peut-être, notre montre ne dira plus “accélère” ou “ralentis”, mais : “Comment tu te sens vraiment ?”
Cette réflexion appelle donc de nouvelles collaborations entre neurosciences affectives, technologie du sport, philosophie du vivant, et psychologie du sens. Elle pourrait nourrir des projets de recherche-action sur le terrain du trail, dans des dispositifs mêlant :
- biosenseurs et analyseur de discours,
- modèles de motivation (self-determination theory, goal setting),
- et design éthique d’interfaces “partenaires” du coureur.
L’enjeu ne sera plus seulement d’aller plus vite ou plus loin, mais de mieux comprendre ce qui nous fait avancer.
(1) Schmidt, L., Lebreton, M., Cléry-Melin, M.-L., Daunizeau, J., & Pessiglione, M. (2012).
Neural mechanisms underlying motivation of mental versus physical effort. PLOS Biology, 10(2), e1001266.
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001266
Références
Amann, M., & Secher, N. H. (2010). Point: Afferent feedback from fatigued locomotor muscles is an important determinant of endurance exercise performance. Journal of Applied Physiology, 108(2), 452–454. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00789.2009
Baron, B., Grappe, F., & Groslambert, A. (2018). Le modèle global du processus de gestion de l’allure pour les longues et ultra-longues distances. Psychology, 9(14), 2837–2850. https://doi.org/10.4236/psych.2018.914163
Baron, B., Grappe, F., Groslambert, A., & Guilloux, B. (2023). An updated model of pacing strategy and performance regulation during long and ultra-endurance exercise: A psychophysiological and motivational approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(9), 5632. https://doi.org/10.3390/ijerph20095632
Csikszentmihalyi, M., & Jackson, S. A. (1999). Flow in Sports: The Keys to Optimal Experiences and Performances. Human Kinetics.
Damasio, A. R. (2000). The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness. Vintage.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Plenum Press.
Gendolla, G. H. E., & Richter, M. (2010). Effort mobilization when the self is involved: Some lessons from the cardiovascular system. Review of General Psychology, 14(3), 212–226. https://doi.org/10.1037/a0019742
Hanin, Y. L. (1995). Individual Zones of Optimal Functioning (IZOF) Model: An idiographic approach to performance anxiety. In Sport Psychology: An Analysis of Athlete Behavior.
Hutchinson, A. (2019). Endure : L’esprit aux limites du corps. Trad. de l’anglais (Endure: Mind, Body, and the Curiously Elastic Limits of Human Performance). Paris : Éditions Amphora.
Marcora, S. M., & Staiano, W. (2010). The limit to exercise tolerance in humans: Mind over muscle? European Journal of Applied Physiology, 109(4), 763–770. https://doi.org/10.1007/s00421-010-1418-6
Mauger, A. R., & Sculthorpe, N. (2010). A new VO₂max protocol allowing self-pacing in maximal incremental exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318206837b
Micklewright, D., St Clair Gibson, A., Gladwell, V., & Al Salman, A. (2017). Development and validity of the rating-of-fatigue scale. Sports Medicine, 47(11), 2375–2393. https://doi.org/10.1007/s40279-017-0711-5
Noakes, T. D., St Clair Gibson, A., & Lambert, E. V. (2004). From catastrophe to complexity: A novel model of integrative central neural regulation of effort and fatigue during exercise in humans. British Journal of Sports Medicine, 38(4), 511–514. https://doi.org/10.1136/bjsm.2003.009860
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68
Saunders, P. U., Pyne, D. B., Telford, R. D., & Hawley, J. A. (2004). Factors affecting running economy in trained distance runners. Sports Medicine, 34(7), 465–485. https://doi.org/10.2165/00007256-200434070-00005
Schmidt, L., Lebreton, M., Cléry-Melin, M. L., Daunizeau, J., & Pessiglione, M. (2012). Neural mechanisms underlying motivation of mental versus physical effort. PLOS Biology, 10(2), e1001266. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001266